L’identité professionnelle dans les écrits professionnels. La représentation de l'identité issue des mémoires professionnels.
Remarques quantitatives
Les occurrences relatives à l’identité professionnelle ont été comptabilisées lorsque le candidat à la certification C.A.P.S.A.I.S. option G émettait une opinion ou un avis sur la définition de cette dernière.
Si nous comparons ces occurrences à la notion d’identité professionnelle, nous retrouvons le même tracé que celui relatif au métier en première partie de cette recherche. Les raisons invoquées sont les mêmes que précédemment. Une enquête sur les plans de formation a été opérée pour vérifier que les interventions de l’équipe des formateurs n’ont pas influencé les stagiaires de l’U.F.A.I.S. de LYON. Le contenu de la formation n’a pas changé au cours des années où la courbe monte. La sensibilité révélée par la courbe est bien celle des candidats. Evidemment, le temps de formation est un temps riche et favorable en interrogation professionnelle. Nous constatons que les réflexions qui sont menées sur les thèmes de l’identité vont de pair avec celles sur le métier. Nous pouvons émettre l’idée que ces réflexions sont l’expression d’une même interrogation : quelle est la fonction sociale de la rééducation ? S’interroger sur le métier revient inéluctablement à s’interroger sur l’identité de l’acteur social qui va le mettre en œuvre. Cette contagion de la réflexion, évidente selon nous, risque de constituer un obstacle à la réflexion sur les deux thèmes : une confusion des deux problématiques est possible et exclurait leur distinction. Nous pensons, outre le fait de la proximité des problématiques, que la coïncidence des tracés résulte aussi de la diffusion des enquêtes de l’Inspection Générale et des textes officiels sur les deux années 1995 et 1996.
Pour mémoire voici les deux tracés sur le même graphique afin de constater l’effet de contagion.
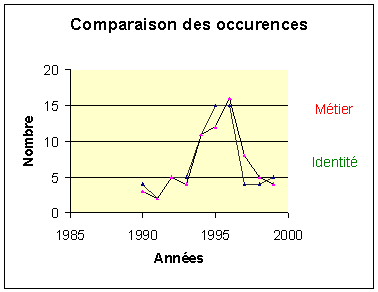 |
 |
La représentation de l’identité « réelle ».
La volonté de changer de profession s’inscrit dans un projet personnel, dans des interrogations personnelles.
Etre candidat à la formation professionnelle C.A.P.S.A.I.S. relève d’un projet personnel. Aucune vocation, parmi celles exprimées dans les mémoires, ne relève d’une incitation extérieure comme cela pourrait être le cas si un inspecteur, un conseiller pédagogique ou un enseignant avait suscité ou accompagner un désir de formation chez les candidats. Les motivations explicites sont centrées sur l’aspiration à mettre en œuvre une nouvelle modalité éducative. Elles sont présentées sous la forme d’un aboutissement logique dans la carrière enseignante. Il est probable que ces explications ne sont que les habits d’aspirations plus personnelles, inconnues et cachées. Une centration forte sur la sphère psychologique est à relever comme si cette attention portée à l’enfant chez l’élève avait manqué lors de la pratique pédagogique antérieure. Les motivations implicites sont davantage ancrées dans des problématiques personnelles. L’espoir ou le fantasme de la réparation ou de la compréhension sont présentés sous plusieurs formes :
« Cette formation s'inscrivait alors comme la résultante de deux formations antérieures. L'une, celle d'enseignante, m'avait enraciné dans une identité professionnelle très prégnante. L'autre, celle d'études en psychologie clinique, m'avait initié aux fonctionnement des processus psychiques humains. Le métier semblait s'inscrire dans une sorte de logique. D'une part il utilisait mes compétences d'institutrices, dans la connaissance que j'avais du développement de l'enfant en général, de ses capacités d'adaptation au premier groupe social la classe, et de ses stratégies d'apprentissage. D'autre part, il faisait appel aux compétences requises par une approche plus psychologique, des difficultés de l'enfant à l'école, difficultés comportementales et cognitives. Intuitivement d'abord, puis étayé par mes études de psychologie, j'entrai dans une écoute plus attentive de ces écarts à la norme. Il était important pour moi, d'essayer d'appréhender de quelles compétences professionnelles pouvaient relever ces écarts. » [1]
« Après une pratique professionnelle auprès d'adolescents et d'enfants relevant de l'éducation spéciale, je me suis engagé dans la formation de rééducateur. Mes motivations étaient l'intervention en amont dans l'histoire scolaire du jeune enfant et la découverte d'une autre forme d'aide. » [2] .
« Le désir de réparation n'était-il pas en train d'éveiller en moi, à mon insu, une fantasmatique de toute puissance, l'illusion de la bonne mère omnipotente ? » [3]
« J'ai beaucoup de joie à aller vers cette nouvelle identité professionnelle. Je mesure tout ce que j'ai encore à apprendre pour acquérir toute une souplesse d'adaptation aux enfants, tout en gardant une rigueur professionnelle. » [4]
« Pour moi, devenir rééducateur, c'est, au sein de l'institution scolaire, faire le choix du singulier, prendre en quelque sorte un chemin de traverse. » [5]
« C'est à la suite de plusieurs années passées avec des adolescents en difficulté scolaire comme instituteur spécialisé que je décidai de demander un stage de rééducateur. Il m'apparaissait alors que l'aide que je décidais apporter à un être en souffrance à l'école passait par une autre relation et d'autres approches du travail. » [6]
« Après avoir pratiqué mon métier d'instituteur pendant une quinzaine d'années, en particulier en maternelle, j'ai progressivement réalisé que ce qui m'intéressait le plus, c'était aider les enfants à bien vivre à l'école et que ceci ne pouvait pas se faire uniquement en affinant l'emploi des techniques pédagogiques à la disposition des enseignants mais également, pour une bonne part, en prenant mieux en compte la relation éducative avec les élèves. » [7]
« J'avais cependant déjà rencontré cette tendance à l'autopunition. A l'automutilation, même. Il y a quelques années dans une classe. Comportement inexplicable et angoissant d'un enfant pour lequel j'éprouvais à la fois de l'attirance et du rejet. Ou de la peur, plutôt. Mais j'ai toujours eu le sentiment que si je l'avais connu dans d'autres conditions que celles de la classe, j'aurais pu le comprendre et l'aider. J'avoue que j'agis maintenant comme si cette occasion se présentait. Occasion de trouver des réponses à cette question restée en suspens : D'où viennent ces souffrances aussi fortes qui amènent ainsi un enfant au bord du désespoir ? Occasion aussi de me racheter de mon attitude de fuite, de refus. Car je sais que ce sont de tels enfants, avec leur excès, leurs écarts aux normes, qui m'ont amené peu à peu vers l'envie de comprendre, d'envisager les choses autrement, de m'engager dans la formation. » [8]
« Durant mes dix-huit années d'école maternelle j'ai souvent été confrontée à de nombreux élèves en difficulté. Je me suis souvent sentie démunie devant des enfants "qui semblaient porter une étiquette" et des enfants "intelligents" mais en panne devant les apprentissages. J'ai toujours essayé de leur porter une attention particulière, personnelle pour les aider à entrer dans les apprentissages en faisant confiance en leur capacité, en ayant une bonne opinion d'eux. » [9]
« Dans ma classe, j'ai toujours été interpellée par les enfants qui étaient en marge. Je sentais, déjà, que beaucoup de nœuds se trouvaient en amont de la vie actuelle de l'élève. C'est le désir de comprendre et de dénouer qui m'a poussée loin de ma ville d'Auvergne et m'a conduite à entreprendre la formation de rééducatrice. » [10]
« Mon passé d'institutrice de maternelle m'avait appris comment être à l'écoute des enfants, dans un climat de confiance et une attitude bienveillante. Au cours de cette année, j'ai découvert avec Miloud une autre écoute, afin de ne pas prendre le symptôme à la lettre. J'ai appris à écouter cet enfant dans ce qui parle à son insu, en tant que sujet et non "objet de rééducation". » [11]
« Au cours de mon métier d'institutrice, j'ai été sensibilisée par les enfants en difficultés scolaires. Je les percevais comme séparés d'eux-mêmes, enfermés dans le cercle de la difficulté. Au cours de ces remplacements [dans l'A.I.S.], j'ai rencontré des élèves en souffrance dans l'école, ne pouvant pas se "poser", accepter d'apprendre, perdus qu'ils étaient dans un histoire scolaire et personnelle souvent difficile. Cette double expérience m'a amenée à penser une troisième voie : le projet de travailler en tant que maîtresse "G", chargée de rééducation, dans un réseau d'aides spécialisées. » [12]
« Je sentais bien, déjà, que beaucoup de nœuds se trouvaient en amont de la vie de l'enfant. Il n'était pas toujours satisfaisant de reprendre des apprentissages de base pour voir les écueils disparaître et redonner l'accès au symbolique à un enfant ? C'est ce désir de comprendre et de dénouer qui m'a amenée à entreprendre la formation de rééducatrice. Amélie m'a aidée à sa manière dans mon cheminement tout au long de cette année. » [13]
« Ma participation à la formation de cette année correspond au désir d'appréhender différemment la relation éducative au sein de l'école. En ouvrant mon action à d'autres possibles, l'aide à dominante rééducative offre un formidable champ de recherches pratiques et théoriques. » [14]
« L'an dernier encore, j'étais enseignante, institutrice spécialisée dans une classe de perfectionnement. En demandant de faire le stage de formation G, j'avais pour but d'acquérir des connaissances qui allaient me permettre d'avoir un autre regard sur les enfants, de les appréhender d'une autre manière. » [15]
Travailler en amont de la difficulté scolaire, relève d’une quête explicative autant sur les raisons de l’échec pédagogique que sur celles de ses propres difficultés à enseigner. Enseigner est associé à une forme d’aide reconnue comme insatisfaisante. Il est sous-entendu qu’une continuité existe entre l’enseignement et l’aide. N’est-ce pas une affirmation artificielle ne répondant qu’à des nécessités personnelles : supposer la filiation entre ces deux fonctions permet de ne pas mettre en avant la rupture entre les deux métiers ? L’évidence de la rupture n’est pas encore supportée psychologiquement, il est donc impératif de la cacher en l’affadissant.
Le temps de formation est d’abord un temps d’interrogation et de doutes. Des retours sur les motivations profondes à l’entrée dans la fonction enseignante sont opérés sans garantir que les réponses soient immédiates. La rédaction du mémoire professionnel joue un rôle unique au-delà de l’exigence institutionnelle : le passage par l’écrit, pour coûteux qu’il soit pour des enseignants qui se sont éloignés pendant de longues années de la rédaction écrite (aucun candidats ne l’évoque mais la rencontre quotidienne bruisse des difficultés rédactionnelles des stagiaires en formation) engage tout auteur dans une réflexion approfondie sur soi et ses actes.
« Les premiers cours reçus à l'I.U.F.M., je les ai entendus avec une grande perplexité. Le changement de métier, le changement d'identité professionnelle revenaient comme un leitmotiv; le mot identité m'a amené à réfléchir sur mes motivations à suivre une formation d'enseignante spécialisée. De l'enseignante à la rééducatrice, une évolution qui me paraissait simple se révélait un chemin couvert d'embûches inattendues. […] Par l'intermédiaire de l'écrit, j'ai tenté d'organiser une réflexion identitaire tant professionnelle que personnelle. De nombreux allers-retours entre théorie et pratique, la confrontation avec la réalité du terrain, des questionnements sur moi-même ont étayé une démarche personnelle tout au long de l'année. » [16]
« Quand à moi, j'essayais de me frayer une voie à travers la houle de mes questions et de mes certitudes, pour m'approprier une nouvelle identité professionnelle. » [17]
« Je pressentais une démarche qui engage l'individu tout entier, non seulement concernant les registres professionnel et théorique, mais aussi personnel. » [18]
« "On fait la course !" : ces paroles prononcées à chaque fin de séances par ce petit garçon [l'enfant pris en charge], qui étaient également pleines de réalité pour moi. Une année scolaire pour changer d'identité professionnelle : n'est-ce pas un peu court ? » [19]
« J'ai l'espoir que ce travail [le mémoire professionnel] a été, tant pour A. que pour moi, un tremplin pour l'avenir, apportant davantage de lucidité, de confiance et de sérénité. » [20]
Le temps de formation est aussi associé à un temps d’explicitation d’évènements ou d’expériences restées obscures ou de confirmation d’hypothèses. Cette quête est avancée comme moteur de la candidature. La confrontation à la norme et au pathologique mobilise aussi les maîtres spécialisés. Georges CANGUILHEM [21] rappelait que le normal n’est que de l’ordre du normatif et relève de la normativité du vivant. Le pathologique n’est pas le contraire logique du normal, il est la reconnaissance par le vivant d’une dévalorisation de sa manière de vivre. L’état pathologique ne signifie pas l’absence de normes : les normes utilisées alors contraignent à vivre dans une vie rétrécie. Le contraire du pathologique est le sain afin que la vie puisse réaliser les tâches quelle juge essentielles. Les divergences de points de vue sur le normal et le pathologique fondent souvent les querelles entre le rééducateur et l’enseignant de la classe ; pour ce dernier, le normal n’est souvent que ce qui doit être, ce qui est attendu. La compréhension des difficultés de l’élève n’est pas désincarnée, elle fait référence à des personnes, à sa personne aussi : un espoir de réparation peut même poindre :
« Devant ma difficulté à traiter l'échec scolaire de certains élèves, j'ai décidé d'entreprendre la formation de rééducateur dans l'espoir de mieux comprendre la problématique de ces enfants en souffrance et d'apprendre à trouver les moyens de leur venir en aide. » [22]
« J'ai choisi de m'engager dans cette formation, parce que depuis longtemps, je me sens concerné par ce constat [l'échec scolaire est une réalité]. Devenir rééducatrice est la suite logique de ma réflexion et de mon travail d'institutrice. » [23]
« « L'être humain est un être de relation et de communication qui a besoin de liberté d'expression et d'échanges avec ses semblables. Tout ceci de mande intelligence et éducation. » Ces phrases de Françoise DOLTO extraites de son livre « Le cas Dominique » illustrent mon passé d'enseignante, qui après de longues années auprès d'enfants, souvent en difficulté, parfois même en souffrance, a décidé de se donner les moyens de leur venir en aide. Formation, rupture, questionnement et me voici un peu perdue sur le chemin inconnu qui doit me conduire vers une nouvelle identité professionnelle. » [24]
« Ma longue pratique d'instituteur spécialisé en institution m'a conduit, au fil des ans, à m'interroger sur la signification de l'échec scolaire comme symptôme. Les pratiques pédagogiques multiples que j'ai mises en œuvre m'ont confirmé la nécessité d'élargir mon regard sur la difficulté. Le temps, le travail de collaboration d'une équipe travaillant dans les domaines spécifiques, firent émerger en moi l'intérêt d'accéder à une dimension plus globale de « l'enfant‑élève ». C'est ainsi que j'ai quitté le rivage exclusif de la pédagogie sans reniement, mais riche de ces acquis, pour aborder celui de la rééducation. D'une rive à l'autre, il faut traverser un fleuve, oser quitter le connu, s'engager au milieu d'eaux profondes, oser perdre pieds à certains moments. Le cadre, les contenus de formations, les personnes qui les assuraient m'ont permis d'aborder confiant l'autre rive. » [25]
« Mon regard a changé sur les enfants de migrants et cette recherche m'a permis de comprendre les raisons profondes de ce non-désir d'apprendre [celui de l'enfant]. J'ai pu aussi me rendre compte combien l'action rééducative pouvait être limitée par l'obstacle que constitue la problématique familiale. Il faut être vigilant pour ne pas menacer l'équilibre familial. Restons humble, on ne peut pas tout résoudre et l'enfant va se construire avec ses parents. » [26]
Le danger de cette personnalisation réside dans le risque de dévoyer la formation d’un professionnel vers celle de la réparation psychique d’un être. Le rappel des missions pendant la formation est ici une exigence.
Cette nouvelle identité suscite un fantasme salvateur de l’enfant comme si le rééducateur avait pour mission de sauver l’enfant en difficulté : ce sauvetage n’est-il pas aussi celui du choix du nouveau métier qui a été opéré et aussi l’espoir de racheter les erreurs anciennes ?
« C'est au croisement de deux chemins que nous avons fait connaissance. Visiblement C. était perdu. J'ai décidé de lui porter secours. » [27]
« J'avais cependant déjà rencontré cette tendance à l'autopunition. A l'automutilation, même. Il y a quelques années dans une classe. Comportement inexplicable et angoissant d'un enfant pour lequel j'éprouvais à la fois de l'attirance et du rejet. Ou de la peur, plutôt. Mais j'ai toujours eu le sentiment que si je l'avais connu dans d'autres conditions que celles de la classe, j'aurais pu le comprendre et l'aider. J'avoue que j'agis maintenant comme si cette occasion se présentait. Occasion de trouver des réponses à cette question restée en suspens : D'où viennent ces souffrances aussi fortes qui amènent ainsi un enfant au bord du désespoir ? Occasion aussi de me racheter de mon attitude de fuite, de refus. Car je sais que ce sont de tels enfants, avec leur excès, leurs écarts aux normes, qui m'ont amené peu à peu vers l'envie de comprendre, d'envisager les choses autrement, de m'engager dans la formation. » [28] .
« A quelles failles, à quelles blessures imaginaires ou réelles le handicap renvoie-t-il ? J.J. GUILLARME dans « Education et rééducation psychomotrices » dit : « Le thérapeute - mais on peut extrapoler au rééducateur - confronté aux atteintes d'un enfant, est renvoyé à la possibilité d'une atteinte personnelle. Il peut développer un désir réparateur excessif ou éprouver une blessure profonde en cas d'échec ». Rééducateur ‑ réparateur ? De l'autre soi ? De soi à travers l'autre ? Pour que l'autre ait besoin de soi ? Fantasme vampirisateur ? » [29]
L’identité professionnelle n’est pas donnée, elle s’acquiert, elle est à conquérir !
Acquérir une nouvelle identité professionnelle relève d’un travail installant le stagiaire dans un entre-deux inconfortable : « Le moment d’entre-deux qui caractérise le passage d’un code et d’une structure de relation à d’autres codes et à d’autres structures relationnelles est conflictuel et il doit être conflictualisé pour être dépassé. » [30] . Les aides sont recherchées, abandonnées et épuisées :
« Ne suis-je pas moi-même dans un position d'entre-deux : plus vraiment institutrice, mais avec certains réflexes dus à de longues années de pratique, pas encore rééducatrice puisque pas suffisamment confrontée à la pratique rééducative,…en formation. » [31]
« Cette année de formation représente à la fois un temps de rupture et un temps de découverte : rupture avec le statut d'instituteur, découverte d'un nouveau métier, celui de rééducateur. Chaque stagiaire, et je n'ai pas échappé à la règle, est donc à la recherche d'une nouvelle identité professionnelle. » [32] .
« Le suivi de cet enfant m'a permis d'intégrer la formation de rééducateur. En début de rééducation, je me torturais l'esprit en me demandant ce que j'avais le droit de faire, ce que je ne devais pas faire ou dire. Aujourd'hui, je sais qu'il s'agit avant tout d'analyser, de repérer mes comportements et de ma questionner sur ce qui a été touché en moi pour que je réagisse ainsi. Progressivement, on se sent traversé par tout le travail théorique que l'on fait et ce travail nous transforme. C'est lui qui va créer une manière d'être particulière avec l'enfant. » [33]
« Vivre un changement c'est accepter de quitter une identité, pour se tourner vers l'inconnu. La nécessité d'un travail sur soi, les échanges avec un tiers pour comprendre ce qui se joue, m'ont permis l'appropriation progressive de cette transformation, de cette nouvelle identité. » [34]
« Plus institutrice mais pas tout à fait rééducatrice, il me faut continuer ma route et trouver une place au sein d'une équipe avec laquelle je vais devoir travailler. » [35]
« Le début de cette année de formation s'est présenté comme une période transitoire : il y a eu un stage en école maternelle où j'ai vu des maîtresses travailler avec des élèves en situation d'apprentissage. J'ai apprécié cette semaine parce que je n'avais pas encore fait le deuil de l'enseignement; j'ai retrouvé sur le terrain tous mes repères professionnels. » [36]
« J'ai moi aussi été confronté au renoncement de mon ancien métier, de mon ancienne identité. Les moments d'analyse, les confrontations avec des données théoriques ont peu à peu modifié ma pratique et l'image professionnelle qui avait été la mienne jusqu'à cette année. Ce travail sur soi que demande la formation à la rééducation m'a permis de me découvrir. Les notions théoriques ont pu me servir de cadre pour retrouver une nouvelle identité. J'ai pu, moi aussi, assumer une position dépressive et accéder à la réparation. Je suis entré dans une nouvelle culture, avec des références nouvelles. Pourtant je sais que je dois rester vigilant. Le désir de former était antérieur à ce nouveau désir d'aider l'enfant à se connaître et à changer pour être mieux avec soi et avec les autres. Cette antériorité peut entraîner des regrets, ressurgir à l'occasion. » [37]
« En effet, qui suis-je moi-même dans mon identité professionnelle ? Plus vraiment une institutrice, pas vraiment une rééducatrice. En formation, ne suis-je pas là, moi aussi, dans une position d'entre-deux, comme Isaac. Entre deux identités professionnelles : celle de l'institutrice que j'ai été pendant dix années, dans laquelle je me suis affirmée et celle de rééducatrice que je ne connais pas encore très bien. C'est un peu comme si, moi aussi je perdais une dimension familière, pour en adopter une autre, étrangère. » [38]
« En même temps que cette adaptation à l'enfant, je prenais conscience des changements qui s'opéraient en moi, dans l'appropriation de ma nouvelle identité professionnelle; passage délicat d'une fonction à une autre : plus vraiment institutrice…pas encore rééducatrice…, un "entre-deux", une transformation qui selon KAËS nous fait "passer d'un code et d'une structure de relation à d'autres codes et d'autres structures relationnelles". » [39]
Cette acquisition n’est pas seulement théorique et réflexive, elle est aussi portée par la pratique, supposée par l’action.
« La créativité dont il s'agit en rééducation, ne se définit pas en terme de technicité ou de projet d'acquisition. Elle se caractérise par l'élaboration d'une démarche, fondée sur une relation intersubjective; l'aire de la créativité étant ce lieu où peuvent dialoguer l'intérieur et l'extérieur de façon à rencontrer ce qui nous arrive, à le faire nôtre, ce lieu d'où peut naître une identité.[…] Pour moi, elle a été l'occasion de comprendre que le travail du rééducateur se situe dans un mouvement dialectique entre l'imaginaire et le réel, la souplesse et la rigueur, l'action et la réflexion, la rencontre et la mise à distance. C'est grâce à ce va-et-vient incessant que s'est tissée une identité professionnelle. » [40]
Malgré un accueil favorable de la part de futurs collègues, les choix personnels sont à défendre. Changer d’identité professionnelle suppose des mouvements volontaires, des choix coûteux, des investissements nouveaux :
« Ce dossier m'a permis d'appréhender les dimensions d'un travail rééducatif, de mesurer l'investissement du rééducateur auprès de chaque enfant. » [41] .
« J'ai découvert qu'il ne suffisait pas seulement de s'être forgé sa propre identité. Encore faut-il pourvoir la faire comprendre aux autres et la faire respecter. Et là se pose le problème de l'institution scolaire. Le rééducateur est soumis en permanence à se justifier vis-à-vis de l'inspecteur, du psychologue, des instituteurs. Chacun d'eux, soit par méconnaissance, soit par fonction propre à chacun, le confronte à toujours se positionner. […] Alors j'ai réalisé que le rééducateur a un rôle de "tampon". C'est à dire qu'il est amené à recevoir, à écouter, à être l'enjeu de bien des conflits : ceux de l'enfant, des parents, de l'école (institution et collègues). » [42]
Acquérir une nouvelle identité professionnelle, c’est d’abord lutter contre l’identité acquise afin d’éviter de courir les risques de la confusion ou de l’indécision. La mise en scène de sa pratique est révélatrice de ses qualités professionnelles ; il n’est donc pas aisé de s’exposer :
« Après avoir rencontré le personnel de deux G.A.P.P. différents qui opposèrent un refus catégorique à la séance unique de la semaine, les rééducateurs du troisième acceptèrent de m'accueillir, malgré une certaine réticence de la part de la RPM qui craignait de devoir rendre compte, d'être "dérangée" dans ses habitudes de fonctionnement. […] Je fis part de mon souhait de me voir attribuer de préférence, en rééducation psychopédagogique, un enfant de maternelle afin de ne pas me laisser entraîner, dans l'acte rééducatif, vers des activités scolaires, activités d'apprentissage proprement dit, proches de celles que j'avais pratiquées en classe de CP d'adaptation au cours de ces dernières années. » [43] .
« En effet, construire une autre identité, celle de la rééducation, demande d'abord de :
- Se séparer d'une situation connue jusque-là,
- D'entrer dans un processus de formation inconnu et angoissant,
- D'établir une relation instituée avec un enfant en difficulté, se distancier pour comprendre, revenir à la relation avec l'enfant, puis s'en éloigner encore : instaurer finalement un va-et-vient entre la situation de rééducation et ce qu'elle suscite pour construire peu à peu une identité professionnelle différenciée. » [44]
…sans éviter des remises en cause…
L’élaboration d’une nouvelle identité renvoie tout professionnel à une situation qu’il a vécu dans son enfance. Les situations ne sont pas maîtrisées ; elles suscitent inquiétudes, doutes, interrogations et choix. Quelle qu’en soit l’issue, elle est dérangeante voire traumatisante pour des personnes ne disposant pas d’une confiance en eux suffisante. Un espace intermédiaire s’ouvre pendant le temps de formation laissant toute latitude de jeu aux appréhensions et aux apprentissages, aux révélations et aux angoisses, aux souvenirs aussi, réels ou imaginés. Un sentiment de culpabilité pointe lorsqu’il est avancé que le nouveau métier puisse délivrer du plaisir :
« Retrouvais-je en moi, grâce à Maxime, l'enfant que j'avais été, et qui avait eu envie de dévorer, tout en redoutant d'être dévoré à son tour ? » [45] .
« Si j'ai permis à mon enfant intérieur, curieux et joueur, de s'emparer de la polysémie de co-errance pour titrer ce dossier, c'est aussi que cela reflète ma quête d'une nouvelle identité professionnelle. » [46]
« J'ai constaté que les questionnements, les incertitudes sont des phases de rebondissement indispensables et constructives pour progresser dans la compréhension d'une situation. Il est nécessaire pour cela de rester très vigilant face à ses propres incertitudes, être capable de les remettre en cause. C'est ainsi que doit se vivre un rééducateur. Cette recherche perpétuelle dans laquelle il doit évoluer doit permettre, selon moi, de garder une ouverture d'esprit et une capacité d'écoute suffisantes pour apporter une aide aux enfants en difficulté. » [47]
« La crise s'instaure dans les deux ruptures auxquelles cette dernière formation m'oblige. Renoncer à mon identité professionnelle [d'institutrice] pour m'en forger une autre, et renoncer à faire référence aux contenus théoriques psychanalytiques, puisque je ne peux pas travailler sur l'inconscient de l'enfant. » [48]
« Je construis ma nouvelle identité professionnelle et je reprends confiance. Ce que j’étais : mon objectif d'enseignante était de faire apprendre. […] Pour que le travail puisse se faire, il était nécessaire que je sois maître et reste maître de ma classe. Sur le plan pédagogique et de la discipline, c'est bien moi qui tenais les rênes, et lorsque je les cédais aux enfants pour un moment, c'était sous mon contrôle attentif. Mon désir était qu'ils apprennent. Leur désir devait être celui d'apprendre. […] Le désir du maître est parallèle à celui des parents. L'enfant soumis à cette pression est en demeure de conformer son désir à celui des adultes. Sinon c'est la menace de l'échec scolaire. Ce que je deviens. Mon objectif de rééducatrice est devenu la réalisation de la personne de l'élève. […] Mon objectif est donc aussi que l'enfant se réhabilite dans sa fonction d'élève, puisque les actions d'aides spécialisées à dominante rééducative se font à l'école […]. » [49]
Des transactions s’opèrent entre les personnes, les statuts et les histoires personnelles. Les stagiaires avouent apprendre leur métier de l’enfant rééduqué, c’est ce dernier qui permet au rééducateur de devenir ce qu’il est. L’aide apportée à l’enfant comporte, par effet retour, une aide apportée au rééducateur. Les temps de formation ont principalement la vocation à médiatiser ces appréhensions en opérant un détour par les théories et les analyses des expériences vécues :
« Après plus de vingt ans de métier d'enseignante, je me retrouvais comme à mes débuts, timide devant l'enfant, ignorante de ce qui allait se passer, me posant mille questions. J'étais à nouveau là pour apprendre. Moi qui pendant toute ma carrière d'enseignante, m'était interrogée sur la façon dont j'allais « apprendre » aux élèves, paradoxalement, j'attendais que cet enfant m'apprenne mon métier. » [50] .
« Il [Kévin] me faisait découvrir que dans le métier de rééducateur, la relation est primordiale. On travaille avec ce qu'on est à l'intérieur de soi, ses émotions et ses peurs y compris. Dans le métier d'enseignant, la dimension relationnelle n'était pas négligeable mais il y avait toujours la médiation des apprentissages derrière laquelle il était possible de se réfugier. » [51]
« En ayant choisi d'exposer la rééducation d'Eda, j'ai voulu montrer que ces choix [les choix de vie] peuvent se produire à tout âge et dans différentes circonstances. En effet, pour elle comme pour moi, il s'agit de choix entre deux « cultures » : turque / française pou Eda, pédagogique / rééducative pour moi. » [52]
« J'ai le sentiment que cette première expérience de rééducation avec ce petit garçon, fut un temps de reconnaissance - mutuelle et de soi-même -, un temps de co-naissance de deux sujets en quête d'une identité, professionnelle pour ma part, d'enfant-élève pour lui. » [53]
« Lorsque j'ai entrepris de me former dans le but de devenir rééducateur (option G), j'étais loin de penser qu'Elise m'aiderait. » [54]
« En toute conscience du chemin qui me reste à parcourir, ce travail m'a permis de regarder derrière moi, d'observer et d'essayer d'évaluer les différentes étapes de mon cheminement personnel et de formation professionnelle qui reste indissociable de celui des deux enfants avec lesquels j'ai travaillé durant toute cette période dans le cadre d'une mise en situation de pratique rééducative. Ce parcours n'aurait pas été réalisable sans l'accompagnement des rééducatrices d'accueil et des formatrices. » [55]
« Brusquement s'écroulent les repères, encore peu assurés en ce qui concerne les enfants, ou trop bien établis pendant vingt-trois ans d'enseignement en ce qui me concerne. Je n'avais pas la possibilité de me retrancher derrière le groupe classe, aussi difficile qu'il soit de gérer à certains moments; ou encore derrière un programme déterminé et préparé. » [56]
« Dès notre rencontre, ALIEN trouve une parole vraie sur la situation qui nous réunit. J'ai l'impression qu'il ma tout de suite acceptée, qu'il va beaucoup m'aider, lui aussi, dans la découverte de mon nouveau métier en étant demandeur, et en attente de l'aide éducatrice. » [57]
…et sans éviter des affirmations nouvelles.
Le professionnel n’existe que par l’objet qu’il instaure comme sien et légitime et la relation qu’il établit avec ce dernier. « Plus que la méthode, la technique ou la médiation employées, ce qui caractérise la rééducation est ce qui se joue dans la relation entre le rééducateur et l’enfant. » [58] rappelle Yves de LA MONNERAYE .
Paradoxalement, c’est l’enfant qui fait l’éducateur, le rééducateur aussi. Aider un être, c’est aussi s’aider soi-même :
« Dans notre quête d'identité, j'ai souvent fait des parallèles entre le changement d'Elfa et le mien.[…] Quant à moi, la formation que j'ai suivie cette année doit me permettre d'assumer la rupture entre une pratique enseignante centrée sur les apprentissages et une pratique rééducative centrée sur la personne de l'enfant.[…] Cette rupture révèle qu'un état d'union et de continuité vient de cesser. Le dérèglement provoqué s'accompagne du sentiment intense d'une menace pour l'intégrité de soi et pour la continuité de l'existence subjective. L'expérience de la rupture suppose que celle-ci a pu être éprouvée et élaborée, dans un espace transitionnel « trouvé-créé » qui apportera à l'être humain la continuité de l'existence personnelle. Cet espace permettra la transition entre le moi et le non-moi, entre le dedans (par exemple le groupe d'appartenance) et le dehors (le groupe de réception), entre le passé et l'avenir. » [59]
« En accompagnant cet enfant dans sa recherche d'identité, j'ai essayé de trouver ma propre identité professionnelle. En le suivant, les innombrables questions qui ont jalonné cette rééducation m'ont donné les moyens d'intégrer cette formation de « rééducateur ». En effet, l'incertitude, le questionnement, ne sont pas des entraves à la compréhension mais plutôt une source d'énergie sans cesse renouvelée. » [60] .
« Comment à travers mes propres interrogations sur l'identité, ne pas comprendre les difficultés d'un enfant à établir la sienne. C'est ce parcours à deux qui permettra peut-être que nos identités se construisent pas interactions successives. » [61]
« Qui a rééduqué l'autre ? Aurais-je envie de dire tant il est vrai que nous avons cheminé chacun dans la compréhension de nous-même. » [62]
« Cette expérience avec V. m'a permis de faire la conquête d'une nouvelle identité professionnelle, de passer d'un état à un autre : instituteur - rééducateur. J'ai commencé mon stage après une vingtaine d'années de pratique pédagogique. Le but de mon travail était bien précis : que mes élèves reçoivent un enseignement. Une fois franchie la porte de l'école, l'enfant était élève, c'était comme ça que je l'accueillais et je l'invitais à se cultiver. » [63]
« J'avais noté au début de ce dossier que « Tout changement d'un seul élément d'un système fait bouger les autres… ». Je sais, que moi, j'ai changé du moins dans mon identité professionnelle : un peu moins institutrice, un peu plus rééducatrice…M. m'a aidée dans ce passage vers une identité professionnelle et je l'en remercie. » [64]
« Comment Sébastien va-t-il me permettre de découvrir un sens différent aux textes [ceux des R.A.S.E.D.] que j'avais consultés avant de commencer cette année de formation ? » [65]
« Aux côtés de Josée, moi aussi j'ai fait du chemin, moi aussi j'ai essayé de trouver du sens, moi aussi j'ai recherché une nouvelle identité. » [66]
« Pendant un temps j'ai été effrayé par cette idée que je pouvais prendre la place du père. Il m'a fallu du temps pour assumer ma propre place : ni enseignant ni parent. Et puis, peu à peu j'ai compris le rôle symbolique que j'avais à jouer, celui de tiers séparateur, de parent psychique. » [67]
Le travail avec un enfant est aussi un travail sur soi comme le rappelle Yves de LA MONNERAYE : « Un enfant nous touche toujours transférentiellement là où nous sommes fragiles, c’est pourquoi nous avons tout intérêt à être nous-mêmes solidement amarrés symboliquement à un tiers qui peut nous entendre dans ce que nous avons à dire de notre travail : telle est la fonction, en effet, de ce qu’on appelle contrôle. » [68] . Cette particularité du travail rééducatif brouille sa lisibilité institutionnelle [69] ; le rapprochement avec le thérapeute est opéré sans prudence alors qu’il en serait de même pour les enseignants qui souhaitent approfondir leur connaissance de la relation pédagogique en participant à des groupes de contrôle, de supervision, Balint ou de soutien au soutien [70] .
La réussite des actions rééducatives est corrélée à la réussite du changement professionnel ; les enjeux sont puissants, d’autant plus que les actes ne sont pas cachés puisqu’ils sont sous le contrôle d’un rééducateur d’accueil et d’un référent responsable d’option :
« En tant que rééducatrice stagiaire, j'ai traversé des moments de doute, d'inquiétude, sur un possible échec de Sylvain qui devenait par ricochet mon propre échec, tout en tenant un cap qui me semblait sérieux alors même que nous empruntions le chemin du jeu. » [71]
« Cette réflexion personnelle me permet de mieux comprendre quelles peuvent être les difficultés d'Isaac à s'établir dans son identité. » [72]
La nécessaire écoute de l’enfant invite le stagiaire rééducateur à un retournement de posture : il doit accompagner l’enfant, il doit être à ses côtés :
« Accompagner quelqu’un, c’est être à ses côtés, là où il se trouve. Accompagner, ce n’est pas réagir, ni intervenir, c’est s’ajuster; ce qui demande une attention permanente à sa propre attitude et notamment une mise en garde contre la fantasme de toute puissance. Accompagner quelqu’un, c’est avoir la conscience qu’il va se passer quelque chose qu’on ne peut pas imaginer d’avance. » [73]
L’écoute du rééducateur reprend les principes des groupes d’analyse de la pratique : « Ecouter le sujet pour lui-même, c’est faire le pari que cela l’aidera à se situer lui-même comme sujet dans sa réalité. » [74]
Si cette posture n’est pas étrangère à tout enseignant qui veut s’enquérir du système de compréhension de l’élève, elle n’est pas généralement prise dans le quotidien tant l’acquisition des contenus est perçue comme urgente. Ici le rééducateur opère une conversion totale puisqu’il devient dépendant de la volonté de l’enfant jusqu’à espérer être « formé » par lui, c’est à dire être désigné comme rééducateur par lui afin d’instaurer une scène rééducative : « Il y a donc à demander à l’enfant s’il veut engager une rééducation et, si oui, il faut clairement lui dire qu’on accepte de l’écouter » [75] . Pour l’anecdote citons la dédicace de D W WINNICOTT qui remerciait ceux qui l’avaient payé pour lui apprendre son métier [76] . J-J GUILLARME [77] explique que le rééducateur doit apprendre de l’enfant. Il ne saura que ce que cet être singulier voudra lui livrer. L’enfant apprend l’écoute au rééducateur. Cette écoute n’est pas passive et compassionnelle, elle a pour but de créer les conditions nécessaires à la mise en place d’un projet rééducatif. Elle est condition et moyen pour la suite. Il serait appréciable que tout enseignant s’imprègne de cette nécessité de respect de l’enfant, sans cela, l’enfant n’est qu’un objet, soit d’étude soit de production.
Un fantasme de renaissance : le nouveau métier fait renaître.
Le nouveau métier nécessite des réaménagements psychiques dont leurs profondeurs ne sont pas prévisibles ; les métaphores possibles sont celles de la maison (la centration est sur l’environnement), et de la peau ou le vêtement (la centration est sur soi-même car un risque de mort a été ressenti) :
« J'avais maintenant obtenu le stage, et confrontée aujourd'hui à cette première expérience de pratique professionnelle, je me sentais tout à la fois impatiente et désarmée devant ce qui m'attendait; j'avais avec moi mon vécu d'institutrice spécialisée, mais je savais qu'il fallait que je me désadapte peu à peu pour me glisser dans cette « nouvelle peau », celle de rééducatrice. » [78]
« Je me trouvais donc au seuil de la maison: pour instaurer une relation d'aide il me fallait prendre le risque d'en franchir ce seuil; pour devenir rééducatrice, il me fallait prendre aussi le risque d'en franchir un autre, celui d'une nouvelle identité professionnelle. » [79]
« J'avais maintenant obtenu le stage, et confrontée aujourd'hui à cette première expérience de pratique professionnelle, je me sentais tout à la fois impatiente et désarmée devant ce qui m'attendait; j'avais avec moi mon vécu d'institutrice spécialisée, mais je savais qu'il fallait que je me désadapte peu à peu pour me glisser dans cette "nouvelle peau", celle de rééducatrice. » [80] .
« J'ai pris conscience que moi aussi j'ai quelque chose à lâcher, que je n'ai pas encore franchi le pas qui rend le retour en arrière impossible, comme le nageur atteignant le milieu de la rivière. Si je veux vraiment me destiner à aider des enfants, je dois accepter aussi de me transformer, d'abandonner les "mues" pour être plus disponible et plus vivant. Concrètement, cela veut dire que je sois inconditionnellement vrai et disponible durant la séance. Que mes ressentis, interrogations, hypothèses soient le thème de l'après-séance. » [81]
Les notions de fonction et de rôle sont perçues dans un premier temps comme une contrainte et une limite. La peau de l’anatomiste est ce qui délimite et qui permet les échanges. La peau protège aussi. Elle est contenante et communicative. Dans le concept du moi-peau de Didier ANZIEU , il s’agit de l’enveloppe psychique du sujet du « […] lien psychanalytique au corps [qui] est d’ordre symbolique et non analogique. » [82] . Le moi-peau est aussi un espace : « L’enveloppe psychique pourrait se comparer à un champ de forces, tel celui développé autour d’un aimant, qui organise en des formes précises, selon les lignes de force, la limaille environnante » [83] . Didier ANZIEU [84] décline plusieurs fonctions à ce moi-peau : maintenance du psychisme, conteneur, pare-excitation, individuation, intersensorialité, soutien de l’excitation sensorielle, recharge libidinale, inscription des traces sensorielles tactiles et d’autodestruction.
Cette nouvelle peau professionnelle n’invalide pas les antérieures, ne les détruit pas. Les repères nouveaux sont à reconstruire. Les métaphores de la peau ou du vêtement rappellent le rapport intime entre identité personnelle et identité professionnelle :
« En commençant cette formation, j'ai laissé mon costume "d'instit" au portemanteau. Ca fait du bien de changer d'habit et je choisissais les textures les plus souples pour ne pas être gênée aux entournures. Cela convenait tout à fait pour les prises de recul et les mouvements giratoires. Plus j'avançais dans la formation, plus j'éprouvais la nécessité d'enlever des épaisseurs. Parfois elles tombaient malgré moi, l'une après l'autre. A certains moments, je me suis demandée si je trouverais quelque chose pour me couvrir. Je n'avais pas toujours bien chaud. […] Quand à mon costume "d'instit", c'est à croire qu'il sort du teinturier. Je ne veux pas m'en séparer (à la rigueur le prêter) mais je le conserverai comme tous les autres. » [85] .
Cette métaphore est à mettre en lien avec la définition lapidaire que donnait Jacques LACAN du Moi : « […] la superposition des différents manteaux empruntés à ce que j’appellerai le bric-à-brac de son magasin d’accessoires » [86] .
« Au risque de l'oubli…Oui, il fallait quitter un lieu, un rôle, pour partir à la découverte d'un autre, accepter de perdre des repères pour en gagner de nouveaux » [87] .
…mais comporte des délimitations.
Tout professionnel a comme premier devoir de définir et délimiter sa fonction, son territoire et ses limites. La mise à nu, pour utile qu’elle soit, rencontre la toute-puissance. Le stagiaire C.A.P.S.A.I.S. doit, tout à la fois, rompre avec son ancien métier qu’il maîtrisait, et tracer les frontières d’un nouveau qu’il ne fait que découvrir. Ce cloisonnement nécessaire à la constitution de son identité lui permet de mettre à jour les confusions. Il n’est pas exclus que cette exigence ne révèle pas une inquiétude quant à sa reconnaissance professionnelle :
« Un autre aspect qui ne me semble pas très positif, c'est l'amalgame que peut faire l'enfant entre le rôle d'enseignant et celui de rééducateur et aussi ne plus sentir les limites de l'aide privilégiée qui lui est donnée en rééducation. » [88] .
La réflexion sur la problématique de l’enfant renvoie le rééducateur à s’interroger sur la sienne lors de son temps de formation. Le travail rééducatif se double d’un travail intime. L’acquisition d’une identité suppose une séparation de la précédente et un temps réservé à la réflexion personnelle. Ce temps de séparation est manifeste lorsqu’il révèle une rupture, une béance pendant ce temps intermédiaire. La formation nouvelle de rééducateur déforme avant de former. Le stagiaire vit une mutation concomitante à l’abandon de sa formation. L’acquisition de la nouvelle identité ne s’effectue pas en empruntant une rampe en pente douce avec franchissement d’étapes pré-établies mais résulte de ruptures, résultats de prise de conscience, preuves d’un processus en cours. Il faut avouer que ces prises de conscience effraient certains par les révélations mises à jour. Ce changement de forme peut relève d’un phénomène sans que l’identité change : HERACLITE avait déjà formulé cette métaphore en expliquant que le changement est phénoménal sans que l’unité de l’être change ; la personne était assimilée à un fleuve identique de sa source à l’embouchure mais toujours changeant dans son déplacement (cette métaphore a été reprise par Hermann HESSE dans le célèbre roman Siddhârta) :
« Je vais parler à présent, du moment, qui m'apparaît être le basculement de ma profession d'institutrice vers celle de rééducatrice. Si avec Rémi il devait y avoir séparation, il y avait aussi la mienne propre, d'avec mon passé professionnel. Il était remarquable, que le sujet de mon travail, puisse se mettre en parallèle avec ma propre démarche formative. La relation avec Rémi, l'attitude de recherche et de questionnements sur ses difficultés, me mettaient face à mes propres questions. "Je me déformais en me formant", en acceptant d'être malléable, de me prêter à …une formation exigeante, dérangeante parfois. » [89]
« J'ai choisi de travailler ce dossier, au croisement de deux axes : […] Celui de l'évolution personnelle, jalonnée par mes interrogations sur la notion de présence dans la relation d'aide, sur celle de l'engagement et des limites, sur les concepts de vie et de mort omniprésents au cours de ce suivi rééducatif. » [90]
René KAËS avait problématisé cette ambiguïté vécu lors du changement identitaire :
« Le dilemme auquel se trouve confronté le sujet en formation peut apparaître ainsi : ou bien renoncer à cet idéal pour n’être pas encore davantage déformé, ‑ mais c’est maintenir le moi défaillant ; ou bien maintenir la visée de cet idéal pour y conformer l’image de soi défaillant, ‑ mais c’est rencontrer inévitablement la déception et l’attaque. Dans les deux cas, c’est la pulsion de mort qui triomphe, en rapport étroit avec l’idéalisation narcissique. » [91] .
La résolution, ou au moins la possibilité de résolution, empruntent une voie difficile ouverte par René KAËS : « L’issue de ce dilemme passe par le travail de la désillusion, et donc par la capacité de l’être en formation d’établir dans la relation formative un champ de l’illusion. Le corollaire de ce processus concerne la capacité du formateur de maintenir une situation formative dans laquelle ce travail puisse s’effectuer. » [92] L’accompagnement du stagiaire par le formateur est décrit plus loin (Cf. « l’acquisition de la nouvelle identité n’est pas une activité solitaire »). Ce conflit psychologique se double d’un conflit socio-culturel : « Le second type de conflit est d’ordre socio-culturel : se former c’est perdre un code social et relationnel, souvent une appartenance de groupe pour tenter d’en acquérir un autre supposé plus adéquat. » [93]
« Venir en stage c'est déjà perdre tous les points de repères professionnels, rompre avec le "conservatisme" de l'existence, c'est perdre la reconnaissance pour risquer une aventure où tout est projet, incertain, tâtonnement. Cette désinstallation a provoqué en moi l'angoisse, l'inquiétude face au changement. J'ai eu l'impression que tout était à refaire. En me réfugiant dans le choix d'une rééducation fonctionnelle je me défendais contre les risques d'une mutation déstabilisante. Mais la richesse de la relation duelle avec V. a été le moteur de l'évolution vers une identité professionnelle nouvelle et petit à petit j'ai laissé mon ancienne assise, je me suis détaché de mon état précédent, assez difficilement quand même : tentation de changement de lieu de stage, de laisser tomber la rééducation commencée, entretien des contacts avec mes collègues de l'école d'origine. » [94]
« La rédaction de ce dossier m'a permis de découvrir d'autres parallèles entre le cheminement de Sébastien et le mien : il était dans l'illusion, je l'ai été aussi parfois quand je recherchais le sens de la rééducation seulement dans des textes. J'espère que la désillusion permettra à Sébastien de se construire des bases qui lui ouvriront les portes de la culture. En ce qui me concerne, je pense qu'elle me permet de construire ma nouvelle identité. » [95]
L’identité du rééducateur s’articule autour d’une relation nouvelle pour un enseignant : la relation à deux.
La pratique de la relation à deux, en face à face lors des séances, perturbe les cadres de pensée de l’enseignant. Incorrectement, elle est nommée « duelle ». Les rééducateurs doivent apprendre à instaurer un tiers afin de ne pas être absorbés par les effets de cette relation : le cadre rééducatif sera le tiers.
« J'ai choisi de travailler ce dossier, au croisement de deux axes : celui de mon évolution professionnelle, avec la nécessité de quitter la situation familière de gestion d'un groupe ‑ classe pour aborder un domaine inhabituel ; celui de la relation duelle. J'ai dû construire peu à peu ce qu'elle représentait, quel rôle j'avais à y jouer, quels moyens je pouvais utiliser face à un enfant en difficulté à l'école […] [96]
« En tant qu'institutrice, je travaillais seule face à trente élèves. C'est un réel changement de travailler avec d'autres sur un même enfant. Cette nouvelle approche me demande d'être claire dans mon rôle et de me différencier par rapport à mes partenaires : ce n'est pas moi l'institutrice, et je ne suis pas là comme un parent, deux rôles qui me sont familiers. Je dois me définir dans ma nouvelle identité : une identité de tiers, une identité de médiateur…une identité dont j'ai conscience mais qui est encore à affirmer. » [97]
« Cette relation de face à face est aussi nouvelle pour lui que pour moi. Ce premier contact m'impressionne autant que lui. En tant qu'enseignante, je suis plus habituée à m'adresser à un groupe qu'à un élève seul. D'autre part, je dois rompre avec mes attitudes aux objectifs pédagogiques et savoir attendre qu'une confiance s'instaure entre lui et moi pour qu'il mette en scène sa problématique. » [98]
« J'ai ressenti que la relation duelle avec un enfant n'est pas quelque chose de simple. Elle est souvent plus impliquante que celle de l'enseignant dans le groupe […].Elle ne permet pas de fuir ou d'esquiver. » [99]
« [la recherche en filiation] Pour moi, rééducateur en formation, c'était me construire, à partir de sources et expériences différentes, une nouvelle identité professionnelle en définissant positivement une éthique. C'était quitter la maîtrise et faire confiance à l'autre, lui reconnaître sa liberté : un place de sujet. C'est cette éthique qui a pu me permettre d'envisager de sortir des différentes relations duelles et de tenter d'instaurer avec l'autre (l'école, l'enseignant, le réseau, les parents, l'enfant) une relation triangulaire. Quitter la maîtrise et accepter d'attendre. » [100]
« Que reste-t-il à faire pour éviter trop de projections sur les enfants, néfastes au travail. En effet, si la situation devient fusionnelle, les problématiques s'entremêlent : les acteurs sont-ils eux-mêmes ou objets d'un perpétuel recommencement sous une forme ou une autre ? J'ai pu moi-même cerner ainsi les points sur lesquels il me reste à travailler ou sur lesquels je suis particulièrement sensible pour éviter de me projeter sur l'autre. Sinon je serais tentée d'appliquer à F. les remèdes, que plus jeune, j'aurais souhaités pour moi-même. » [101]
Mais l’enseignant reste le père du rééducateur.
Devenir rééducateur suppose, au préalable, une maîtrise pédagogique et didactique chez l’enseignant. La pratique rééducative n’est pas en lévitation dans la pratique scolaire, elle poursuit, au moins fantasmatiquement, l’action enseignante :
« A ce moment de ma formation, j'ai le sentiment que mon attitude pour aider Jules est fonction de ma situation de stagiaire et que mon vécu professionnel d'instituteur n'est pas loin. » [102] .
Il semble exclus qu’un professionnel ne disposant pas de ce vécu d’enseignant puisse poursuivre l’action engagée en classe. Si le stagiaire dispose de compétences avant de débuter sa formation, il n’est pas certain quelles soient utiles dans la nouvelle profession. Sauf à être mise à distance, afin de rendre authentique la rééducation.
« Au bout de quelques bonnes années d'enseignement, j'avais acquis, je crois, une compétence dans ma profession qui me donnait l'assurance d'un savoir, d'une expérience. Au jour de la séance, je n'étais plus maître(esse) du jeu. Je me voyais dans Rémi : la tête dans la bassine, à la pêche de nouveaux objets ! » [103]
Les identités en conflit : celle du rééducateur avec celle de l’enseignant
Le partenariat enseignant – rééducateur, pour autant nécessaire qu’il soit, ne garantit qu’une concorde de principe. La différence des points de vue et des missions suscite une rivalité expliquée en grande partie par deux arguments : les deux partenaires partagent la même origine (un reproche est souvent exprimé par les enseignants en classe qui arguent de la relation individuelle avec l’élève en sous entendant que tout est facilité dans le rapport à deux) et la même mission – l’entrée dans les apprentissages (bien que le rééducateur n’ait pas à mettre en œuvre l’enseignement des disciplines scolaires) :
« A l'issue de cette rencontre, je prends conscience d'une légère rivalité, discrètement exprimée par la maîtresse : "Avec toi, il n'a pas toutes ces difficultés…". » [104] .
« L'emploi de ce terme d'éducabilité, dans un dossier axé sur la rééducation, posait le problème du rapport entre l'éducation et la rééducation. Il évoquait l'ambiguïté de la position du rééducateur. A travers ce mot, le domaine pédagogique voisinait avec le champ de la rééducation, mon identité de pédagogue avec celle de rééducateur. Je me trouvais confronté à leur proximité et à leur différence. » [105]
« La position du rééducateur est parfois inconfortable car au-delà du symptôme de l'enfant, il va essayer d'interroger la relation maître / élève et aider le maître à exprimer ce qu'il ressent, à verbaliser pourquoi cet élève le déstabilise. » [106]
« A l'issue de cette rencontre, je prends conscience d'une légère rivalité, discrètement exprimée par la maîtresse : "Avec toi, il n'a pas toutes ces difficultés…". » [107]
Il est fort probable que la rivalité entre les professionnels puise aussi sa source dans la concurrence d’influences sur l’élève que chacun espère ou fantasme. Ce fantasme de formation a été décrit par René KAËS : « Le désir du formateur est le moteur du travail et du plaisir éprouvé dans ce travail : désir que l’autre développe ses capacités de vie optimales. Tel est le sens de l’effet Pygmalion. » [108] . Si l’enseignant médiatise son désir de formation par les matières enseignées, le rééducateur doit créer un cadre, installer des situations et proposer des objets intermédiaires pour que la relation évite le piège de la psychothérapie. Les deux professionnels portent le même fantasme mais l’expriment dans des cadres différents. La concurrence provient de cette communauté. Il n’est pas définitif qu’elle soit négative. Le reconnaissance et le bénéfice de la complémentarité reste encore à promouvoir.
La définition de l’identité professionnelle reste une tâche difficile et complexe. Le premier mouvement est de se différencier par la négative. Il est certain que cette approche n’est pas un gage de compréhension pour l’interlocuteur. Hélas, ce premier temps est nécessaire pour se séparer de son identité précédente. Encore une fois, c’est le rapport à l’enfant qui exige ces précisions :
« C'est en essayant de clarifier mon rôle, d'expliciter ma fonction auprès de Jérôme, de sa maman, de son institutrice que j'ai pu ensuite parler de mon métier en termes positifs et compréhensifs. Au début, je faisais un peu comme Jérôme : je ne suis pas …psychologue, « je ne fais pas de l'orthophonie », « je ne fais pas de la gymnastique »…définitions en négatif ! » [109]
L’acquisition d’une nouvelle identité n’est pas une activité solitaire et retournée sur soi-même.
Elle procède d’un travail à mener avec un pair, miroir de ses doutes et support permettant les progrès. Le rôle du formateur surgit ici comme un passeur nécessaire. Ce n’est pas lui qui est à imiter mais ses capacités, révélées par les échanges. Il oriente le regard sur les obstacles qui ne sont pas reconnus, il fait advenir cette identité nouvelle comme un éducateur travaille à l’éveil de son élève : il élève le stagiaire comme le rééducateur élève l’enfant :
« Par sa capacité à accepter l'enfant « tel qu'il est » et à respecter ses silences, ses choix, ses réalisations, elle [la formatrice d'accueil] m'a donné à voir l'activité contenue dans cette passivité, c'est à dire ne rien faire "à tout prix" mais laisser à l'enfant la possibilité d'exprimer quelque chose de sa vie intérieure, de ses propres joies, de ses souffrances. » [110]
« Au cours de cette année de formation, j'ai connu l'incertitude, le doute, la peur, le manque d'estime de soi. Ils auraient pu constituer un obstacle insurmontable si je n'avais pas été encouragée par ma rééducatrice d'accueil et la formatrice de l'IUFM et soutenue par mes collègues. Ces sentiments faisaient écho avec ceux que je sentais poindre en Ella. » [111]
« Un dialogue, une écoute réciproque se sont instaurés avec la rééducatrice qui m'a accueillie. Ces entretiens m'ont permis de me situer dans une démarche où j'apprends ce nouveau métier en faisant des liens entre les lectures et l'acte même de la rééducation. » [112]
« Etre élève est difficile, tout comme l'est le métier de rééducateur, car il faut se forger une identité dans la réflexion, l'analyse et le retour permanent sur soi, dans la confrontation de ce que livre l'enfant de lui-même et de ce qui a été touché en nous. Ce mouvement qui ne s'arrête jamais est la garantie d'un bon épanouissement dans ce métier. » [113]
Une identité professionnelle fondée sur des originalités et des qualités propres
L’identité professionnelle du rééducateur fait référence à une attitude originale chez l’enseignant : la non-maîtrise revendiquée : « L’intérêt, c’est l’écart introduit par rapport à la situation pédagogique traditionnelle. La difficulté réside en ce que l’on suit pas à pas l’enfant plus qu’on le précède : on n’exerce aucune maîtrise sur la situation. » [114] Il en est de même pour la non-directivité :
« Difficile à accepter aussi la non-directivité avec laquelle en tant qu'instituteur nous ne sommes pas familiers. » [115]
« Changer d'identité professionnelle peut paraître simple à première vue, mais aujourd'hui je me rends compte que cela a été un peu moins facile qu'il n'y paraissait. Il faut renoncer à tout comprendre, à tout maîtriser, à ne rien oublier; à bien faire…En début de rééducation, je me torturais l'esprit en me demandant ce que j'avais le droit de faire, ce que je ne devais pas faire ou dire. Aujourd'hui je sais qu'il s'agit avant tout d'analyser mes ressentis, de repérer mes comportements et de me questionner sur ce qui a été touché en moi. » [116]
« Lorsque j'étais institutrice, mon rapport à l'enfant était celui de la maîtrise implicite ou explicite. Dans les séances de rééducation, le jeu de maîtrise s'établit de façon alternée, imprévisible, surprenante. Je m'aperçus alors que je ne possédais plus le code pour gérer ces situations inconfortables. » [117]
Cette non-maîtrise s’exprime par un refus du savoir total, de la toute puissance ; celle qui enferme et condamne dans le même temps ceux que l’on souhaite aider.
« Dans les entretiens avec les familles, le rééducateur ne se situe pas dans le « tout savoir ». Il ne place pas les parents dans l'obligation de tout dire. Les silences sont accueillis et respectés. L'objectif est qu'ils comprennent l'intérêt du travail rééducatif et qu'ils soient désireux de revenir. » [118]
« En début de rééducation, j'éprouvais des difficultés en me posant sans cesse la question de ce que je pouvais m'autoriser à mettre en œuvre ou de ce que je ne devais pas faire ou dire. Aujourd'hui, je comprends qu'en priorité, il s'agit de bien repérer, analyser mes attitudes, réfléchir sur ce qui se passe en moi et sur ce qui me touche. C'est aussi renoncer à vouloir tout comprendre, tout savoir en imaginant que tout se joue dans la transparence. » [119]
« Ce qui me semble difficile, c'est d'avoir cette capacité d'adaptation à chaque enfant ayant des problèmes différents, tout en préservant sa spontanéité, sa capacité d'empathie, son indestructibilité; c'est avoir un rôle de contenant (pôle maternel) pour certains, de conteneur structurant (pôle paternel) pour d'autres. » [120]
« Pour conclure ce travail, il me semble important de consacrer quelques lignes à mon évolution personnelle. Cela a été possible grâce au temps de formation théorique et aux deux rééducations dans le cadre de la pratique professionnelle. Il a fallu tout d'abord accepter le changement d'identité professionnelle; cela peut paraître simple à première vus mais aujourd'hui, je me rends compte que cela a été un peu moins facile qu'il n'y semblait. Par exemple, il s'agit de renoncer à la volonté de tout comprendre, de ne rien oublier; j'évoquerais ma tentation de trouver une méthode comme l'enregistrement ou la prise de notes pendant la séance. N'étais-ce pas ce désir de maîtriser une situation, de bien faire ? A ce propos, quand je parle de bien ou de mal cela ne renvoie-t-il pas au faux ou au juste de l'ancienne écolière ? » [121]
« Alors, au cours de ce voyage [la rééducation] , j'ai dû abandonner l'idée de "toute puissance" que me conférait le rôle de maître, oser vivre l'insécurité pénible mais créatrice, approcher d'un peu plus près l'humilité et l'authenticité. C'est une œuvre sans fin qui conduit du paraître à l'être. » [122]
S’il est loisible au rééducateur d’accéder à un grand nombre d’informations, il lui faut ménager une réserve afin de garder la distance nécessaire à l’exercice de sa fonction. Il ne s’agit pas de secrets mais d’une condition de l’exercice de sa fonction de médiateur. Cette distance est partagée avec tout éducateur :
« Il n’en demeure pas moins que ce qui caractérise fondamentalement l’attitude de l’enseignant, c’est d’être à distance raisonnable de l’élève et non de le tenir par la main, car c’est la condition indispensable pour qu’il puisse faire lui-même le chemin d’apprendre. » [123]
« Les moyens pédagogiques doivent toujours venir au service du maintien de cette distance entre l’élève et le maître, qu’implique la parole. » [124]
Faire usage de la parole est la garantie d’une distance maintenue ; ce n’est que dans la fusion qu’elle est inutile et dangereuse :
« Je pense que le rééducateur doit respecter ce que chacun donne à voir et à entendre, tout en mettant entre parenthèses différentes informations pour rester à l'écoute du sujet et ne pas se laisser gagner pas les inquiétudes de l'environnement. » [125]
L’identité professionnelle du rééducateur se situe à un carrefour, elle est intermédiaire, elle est paradoxale. Elle se situe dans un entre-deux.
Si l’inconfort est de mise, sa situation stratégique lui permet d’assister ou de participer au fonctionnement institutionnel de l’école. Il est en position de savoir sans être pris dans la passion des conflits ; le danger résiderait dans la divulgation des dysfonctionnements observés.
« Le rééducateur a une place paradoxale, à la fois dans l'école et hors de l'école. Il est un instituteur spécialisé qui travaille au sein de l'école pour le devenir de l'élève. Mais il n'est pas dans l'école au même titre que ses collègues chargés de classe. Par le fait qu'il n'est pas « chargé de classe », le rééducateur peut prendre du recul par rapport à la difficulté d'un élève. » [126]
« Le rééducateur est dans le système et en dehors, ce qui facilite la compréhension et l'action. Il est moins intriqué dans des relations quotidiennes avec l'enfant que l'est son collègue de la classe. Ce qui lui permet de prendre du recul par rapport à la situation. » [127]
« En cette fin de formation, la rééducation m'apparaît bien comme un lieu de passage, un entre-deux dans l'école. Je suis dans l'école, je n'utilise pas les outils de l'école. C'est un temps hors du temps scolaire : un temps fait d'écoute, de patience, de disponibilité afin que par notre présence, l'enfant puisse découvrir, inventer son propre chemin pour devenir élève. » [128]
« En effet, au cours de cette année de formation, je me suis sentie personnellement fortement sensibilisée aux notions « d'aire intermédiaire », « d'espace transitionnel », de « zone de proximité ou d'empiètement », « d’ajustement », « d’accordage dans une relation », que développaient les apports théoriques, autant « d'entre-deux » que j'ai pris plaisir à laisser entrer en résonance, pour en comprendre l'importance. Peut-être ces termes trouvaient-ils en moi un terrain favorable, en écho à ma propre identité, entre « orient » par mes racines, et « occident » par ma naissance ? » [129]
« Le rééducateur est comme un passeur. Passeur d'une rive à l'autre, de la rive de l'expression d'une souffrance à celle de l'expression. » [130]
Le rééducateur est un enseignant qui aide.
L’aide n’est pas concentrée (restreinte) sur les savoirs mais s’adresse à l’enfant dans sa totalité, dans sa globalité. « Maintenir l’aide à l’« enfant‑élève » dans l’institution scolaire, c’est simplement affirmer le « droit à la difficulté, au dysfonctionnement », pour un sujet normal ou en devenir. » [131] . Nous avons déjà différencié théoriquement ses deux formes : « Disons pour simplifier que l’on trouve deux sortes d’aides que l’on peut appeler rééducatives : une forme de rééducation dite « relationnelle », centrée sur l’aide à symboliser, à « parler » au sens fort, avec tout ce que cela implique, et une ou des formes de rééducation dites « fonctionnelles », centrées sur la compréhension de la manière dont on apprend et dont on se bloque. » [132]
« En partageant un peu de cette histoire d'une rééducation dans laquelle j'ai cherché à allier la dimension créative avec la dimension professionnelle, j'espère avoir communiqué ce qui fonde mon identité de rééducatrice : aider, accompagner l'enfant dans "la restauration du désir d'apprendre et de l'estime de soi" ainsi que le signifie la circulaire sur la mise en place et l'organisation des réseaux. » [133]
« La particularité du rééducateur de servir de point d'appui vivant pour l'enfant a été l'aspect le plus pour moi à intégrer. Ce positionnement nouveau impliquant une participation active m'a enthousiasmée, en même temps qu'il m'a montré me limites. » [134]
Cette aide prouve sa réussite en disparaissant. L’ingratitude est de règle lorsque l’on aide, le principe de non-réciprocité s’impose. Emmanuel LEVINAS [135] rappelle que selon ce principe, on est responsable d’autrui et l’on doit persévérer en ce sens. Nous ne pouvons nous cacher derrière les défaillances de l’autre pour ne pas faire. Les devoirs l’emportent sur les droits.
« Sa tâche est d'aider l'enfant perdu, son destin est de disparaître lorsque l'élève est retrouvé. » [136]
Le piège du conflit identitaire, rééducateur ou thérapeute : des qualités communes à des identités différentes.
La situation d’entre-deux du rééducateur lui impose une articulation entre des champs proches mais néanmoins distincts : rééducation et psychothérapie. Tout emprunt fait courir le risque de la confusion. De même, le refus de courir ce risque tarirait la rééducation comme nous l’avons montré en première partie.
« […]si le rééducateur se doit d'avoir des connaissances pour analyser les situations vécues et nourrir sa réflexion afin d'être clair et juste quant à sa présence et son travail avec l'enfant, il n'est pas psychothérapeute. » [137]
« Je ne suis pas psychothérapeute. Même si j'utilise dans mon travail différents outils (psychanalyse, théories de la communication, théorie systémique, théorie des apprentissages), je ne travaille que dans le réel et le présent de l'enfant. Les notions d'empathie, d'attention flottante, d'écoute bienveillante sont très utiles dans la relation avec l'enfant mais en aucun cas ces outils ne me servent à communiquer au niveau de l'inconscient. Si je donne mon sentiment devant un acte que je crois porteur d'une symbolique, cela reste dans le registre de la communication : ce n'est ni une interprétation, ni une vérité que je révèle à Rémi. Je lui renvoie une image qui correspond à l'effet que m'a fait une des ses actions. Je « prête » à Rémi ma pensée et mon langage pour qu'il ait un autre regard sur elles. Il peut ainsi faire des liens entre des pensées et des actions, liens symboliques qui n'avaient pas forcement accès au registre du langage. » [138]
« La théorie psychanalytique est un outil parmi d'autres qui permet au rééducateur de comprendre « ce qui se passe » mais son action est celle d'un médiateur et non celle d'un thérapeute. » [139]
« Lors du récit de cette entrevue par la rééducatrice, s'est posée à moi la question des qualités du rééducateur : la bienveillance et notamment l'empathie, consistant à entendre l'émotion de son interlocuteur, sans en être affecté toutefois. » [140]
Au-delà l’enquête qui a recueilli la parole des rééducateurs et les mémoires professionnels qui a mis en valeur leur attention à la problématique identitaire, le parcours des écrits du corps professionnel permet de mesurer la cohérence de leur réflexion.
[1] BLANC (Nicole), op. cit., p 1.
[2] POINSARD (Gérard), De l'imaginaire à l'imagination partagée, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1992, p 1.
[3] MALYCHA (Fabienne), Comme une maison abandonnée, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, LYON, 1996, p 29.
[4] THIMONIER (Suzanne), Un film tout en couleur. Au fil des séances, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié 1996, p 26.
[5] LAMBERT (Jean-Marie), op. cit., p 26.
[6] PICHERY (Michel), op. cit., p 5.
[7] JOHANNET (Marc), op. cit., p 1.
[8] GAUDENZ (Gérard), Guillaume et l'instabilité, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1992, p 1.
[9] ARPINO-GIRERD (Françoise), Apprendre, c'est risquer. "Pars, sors du ventre de ta mère…", Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1999, p 1.
[10] DUMAS (Régine), op. cit., p 1.
[11] PLANET (Astrig), Entre-deux, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1995, p 32.
[12] MICOLOD (Catherine), Ecole - Famille. De la séparation à la différenciation, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1997, p 1.
[13] SIMON LECONTE (Jacqueline), Etre seul en présence de…Etre seule. Histoire d'Amélie, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1996, p 1.
[14] BACOT (Eric), A la découverte de l'autre…, op. cit., p 1.
[15] JOURDY (Michelle), Rééducateurs instituteurs des partenaires, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1991, p 1.
[16] FROBERT (Catherine), Adrien et le loup, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1995, p 1.
[17] AUDIGIER (Geneviève), La petite fille qui faisait tout à l'envers, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1995, p 1.
[18] Ibid., p 2.
[19] PICHERY (Michel), op. cit., p 5.
[20] Ibid., p 33.
[21] CANGUILHEM (Georges), Le normal et la pathologique, Paris, PUF, 1966.
[22] COULON (Agnès), op. cit., p 1.
[23] ROLET-SCHEURER (Lydie), op. cit., p 2.
[24] DESMURE (Lucette), op. cit., p 1.
[25] DROUHET (Jean-Michel), Est-ce que vous pouvez trouver le papa de Brice ?, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1997, p 5
[26] DOLO-PERROUX (Christine), Le pays de l'entre-deux, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1997, p 28.
[27] RENAULT (Monique), op. cit., p 5.
[28] GAUDENZ (Gérard), op. cit., p 1.
[29] LAPORTE (Nicole), Un enfant trisomique en rééducation, son cheminement, celui du rééducateur, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1990, p 5.
[30] KAËS (René), Fantasme et formation, Paris, BORDAS, 1984, p 74.
[31] ETIENNE BOIRON (Chantal), Des regards fondateurs de l'identité, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1994, p 24
[32] HOLLANDE (Nicole), Les limites d'une rééducation, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1994, p 1.
[33] MICHEL (Marielle), Un enfant limité ou un enfant sans limite. Du signalement à l'indication, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1996, p 30.
[34] BOUARD (Alain), Le "Nom dit"…, op. cit., p 34.
[35] RENAULT (Monique), op. cit., 1996, p 38.
[36] MEZINO (Gérard), op. cit., p 33.
[37] FORCOLIN (Alain), op. cit., p 39.
[38] PRON (Catherine), op. cit., p 22.
[39] PLANET (Astrig), op. cit., p 34.
[40] AUDIGIER (Geneviève), op. cit., p 34.
[41] CLARET (Monique), Cheminement d'une rééducation, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1990, p 33.
[42] NEVERS (Marie – Michèle), R comme Réalité Réflexion sur Réseau rural, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1993, p 20.
[43] THIERRY (Alain), op. cit., p 3.
[44] MICOLOD (Catherine), op. cit., p 31.
[45] DASSING-BLUM (Noémie), Les liaisons dangereuses, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1993, p 21.
[46] ROUVRAY (Sarah), La co-errance, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1996, p 2.
[47] LIOURE (Françoise), op. cit., p 34.
[48] BLANC (Nicole), op. cit., p 19.
[49] Ibid., p 36.
[50] CLARET (Monique), op. cit., p 1.
[51] VERHOVEN (Josette), Allo…ne coupez pas, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1994, p 19.
[52] BRUN (Sylvie), op. cit., p 35.
[53] FARGIER (Muriel), op. cit., 1996, p 35.
[54] GRENIER (Jean Pierre), De A à G. Histoires de changer, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1997, p 0.
[55] LOPEZ (Christiane), op. cit., p 1.
[56] Ibid., p 1.
[57] TRUCHOT (Michèle), op. cit., p 1.
[58] LA MONNERAYE (Yves), op. cit., p 13.
[59] AUDIGIER (Geneviève), op. cit. , p 31.
[60] BONDON (Joëlle), Suivre afin d'être, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1993, p 32.
[61] ETIENNE BOIRON (Chantal), op. cit., non publié, 1994, p 25.
[62] GRENIER (Jean Pierre), op. cit., p 21.
[63] MEZINO (Gérard), op. cit., p 32.
[64] REYMOND-ARSAC (Solange), op. cit., p 29.
[65] GAYET (Nicole), A la recherche d'un sens, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1996, p 2.
[66] POMEL (Simone), op. cit., p 36.
[67] SYDENIER (Pierre), op. cit., p 29.
[68] LA MONNERAYE (Yves de), op. cit., p 98.
[69] Rédacteur M. GOSSOT, Le fonctionnement des RASED, Rapport de l’Inspection Générale de l’Education nationale, 1995.
[70] Extrait de l’article 2 du statut de l’association A.G.S.AS : « La méthode mise en œuvre est celle dite du "Soutien au Soutien" : elle procède d'une adaptation de la méthode Balint en fonction des besoins spécifiques de formation des personnes travaillant dans les domaines indiqués ci-dessus. Dans ce but, elle se propose : - de soutenir les personnes désireuses d'acquérir un autre regard sur l'exercice de leur profession et les problèmes concrets qu'elles rencontrent du fait de l'hétérogénéité de la population scolaire et du fait de l'évolution de la société dans les domaines familial, social et culturel, - d'apporter à ces personnes des méthodes de réflexion et d'action mises au point au travers du fonctionnement de groupes abordant les problèmes sous le double éclairage de l'expérience pédagogique et de l'expérience psychanalytique, en référence aux concepts et méthodes élaborés par Jacques LEVINE, - de rassembler un corpus de témoignages d'expériences diversifiées et représentatives des populations concernées afin de les théoriser et de les diffuser. »
[71] DELHAYE (Muriel), Du rôle d'accompagnateur à celui de médiateur…le cheminement de la formation, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1994, p 1.
[72] PRON (Catherine), op. cit., p 23.
[73] Le BOUËDEC (Guy), « Diriger, suivre, accompagner : au-dessus, derrière, à côté », Cahiers Binet Simon, n°655, 1998, pp 53 à 64.
[74] LA MONNERAYE (Yves de), op. cit., p 186.
[75] .Ibid., p 198.
[76] Bien sûr, la citation exacte doit être comprise au second degré en ce qui concerne le sens du mot « payé » : « A mes patients qui ont payé pour m’instruire ». Bien entendu, au delà du coût financier des consultations, les patients ont du investir la relation thérapeutique avec le psychanalyste et cela leur a « coûté » psychiquement.
[77] GUILLARME (Jean-Jacques), Education et rééducation psychomotrices, Paris, Sermap - Hatier, 1982.
[78] DIZIER (Isabelle), La rééducation de MALKO, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1992, p 1.
[79] MALYCHA (Fabienne), Comme une maison abandonnée, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1996, p 1.
[80] DIZIER (Isabelle), op.cit., p 1.
[81] GRENIER (Jean Pierre), op. cit., p 19.
[82] HOUZEL (D) in ANZIEU (D), « Les enveloppes psychiques », BORDAS DUNOD, Paris, 1987, p 39
[83] HOUZEL (D), op. cit., p 40.
[84] ANZIEU (D), op. cit., p 51.
[85] VIEL (Nathalie), Un cheminement difficile, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1994, p 22.
[86] LACAN (Jacques), « Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse », in Le séminaire, Livre II, Paris, Le Seuil, 1978, p 187 ; cité par HOUZEL (D), op. cit., p 36.
[87] FIAULT (Noëlle), Moi et le jeu, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1995, p 1.
[88] CLARET (Monique), op. cit., p 1.
[89] FIAULT (Noëlle), op. cit., p 29.
[90] FIORENZANO (Jacqueline), Il était une fois…, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1994, p 2.
[91] KAËS René, Fantasme et formation, éd. BORDAS, Paris, 1984, p 73.
[92] KAËS (R), op. cit., p 73.
[93] KAËS (R), op. cit., p 74.
[94] MEZINO (Gérard), op. cit., p 34.
[95] GAYET (Nicole), op. cit. p 27.
[96] FIORENZANO (Jacqueline), op. cit., p 2.
[97] PRON (Catherine), op. cit., 1993, p 2.
[98] LIOURE (Françoise), op. cit., p 7.
[99] GUETTET (Bernard), Avec Anthony "Est-ce bien de grandir ?", Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1994, p 24
[100] KRIVOZOUB (Pierre), Pour être deux…il faut être trois, ?", Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1998, p 36.
[101] MOUSSUS (Aleth), op. cit., p 1.
[102] POINSARD (Gérard), op. cit., p 13.
[103] FIAULT (Noëlle), op. cit., p 30.
[104] HERAUD (Marie-Claude), Histoire d'une rééducation, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1992, p 27.
[105] TEYBER (Serge), Le pari d'éducabilité. Des ruptures à la continuité, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1995, p 1.
[106] BRUN (Sylvie), op. cit., p 6.
[107] HERAUD (Marie-Claude), op. cit., p 27.
[108] KAËS (René), op. cit., p 72
[109] FIORENZANO (Jacqueline), op. cit., p 9.
[110] FIORENZANO (Jacqueline), op. cit., p 5.
[111] DUMAS (Régine), op. cit., p 1.
[112] MICOLOD (Catherine), op. cit., p 31.
[113] ROG (Jean-Louis), La reprise ou comment restaurer l'estime de soi, 1998, p 32.
[114] LA MONNERAYE (Yves de), op. cit., p 23.
[115] BRUN (Sylvie), op. cit., p 36.
[116] RENAULT (Monique), op. cit., p 39.
[117] BLANC (Nicole), op. cit., p 2.
[118] BOUARD (Alain), op. cit., p 5.
[119] Ibid., p 34
[120] FILIBERTO (Christian), op. cit., p 31.
[121] TERGNY (Nadia), Un nom sans père, un père sans nom., Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1994, p 29.
[122] DROUHET (Jean-Michel), op. cit., p 4.
[123] LA MONNERAYE (Yves de), op. cit., p 19.
[124] Ibid., p 20.
[125] TABOUNTCHIKOFF (Jocelyne), op. cit., p 28.
[126] POMMIER (Jean-Luc), Méchante ! La rééducation, une solution pour la prévention de la violence à l'école, Mémoire professionnel C.A.P.S.A.I.S. option G, non publié, 1997, p 3.
[127] Ibid., p 38.
[128] ARPINO-GIRERD (Françoise), op. cit., p 19.
[129] PLANET (Astrig), op. cit., p 1.
[130] SIMON LECONTE (Jacqueline), op. cit., p 29.
[131] LA MONNERAYE (Yves de), op. cit., p 28.
[132] Ibid., p 83.
[133] FIORENZANO (Jacqueline), op. cit., p 23.
[134] DE LUNA Florence, op. cit., p 23.
[135] LEVINAS (Emmanuel), Ethique et infini, Paris, Fayard, (Poche‑biblio‑essais), 1982.
[136] ROLET-SCHEURER (Lydie), op. cit., p 41.
[137] ROUVRAY (Sarah), op. cit., 1996, p 30.
[138] FORCOLIN (Alain), op. cit., p 34.
[139] JOHANNET (Marc), op. cit., p 17.
[140] HERAUD (Marie-Claude), op. cit., p 9.